Le doux défi de combiner l'écriture créative et l'écriture scientifique
Une chronique publiée le 27 février 2025
Écrire beaucoup au travail et en remettre une couche à la maison, ça ne frôle pas un peu le masochisme ? Question légitime, surtout quand on écrit aussi bien des articles scientifiques rigoureux qu'une fiction libre et débridée. Pourtant, ces deux formes d'écriture sont si distinctes qu'elles ne s'annulent pas, mais s'alimentent l'une l'autre. Entre la précision chirurgicale du papier scientifique et l'exubérance narrative de la fiction, mon cerveau passe simplement d'un plaisir créatif à un autre.
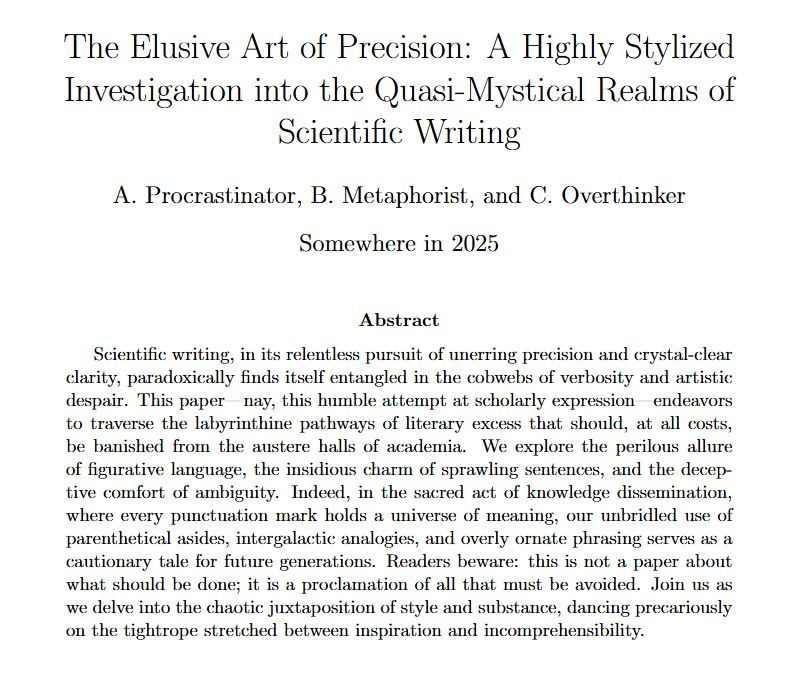
« C’est pas lourd d’écrire de la fiction alors que, dans ton boulot, tu écris déjà beaucoup ? »
Encore une question qui revient souvent !
D’habitude, j’y réponds gentiment (du moins si la personne qui me tutoie possède bien ce niveau de privilège 🤔), en suivant les idées suivantes.
🔬 L’écriture d’articles scientifiques, ou d’une thèse complète, est un exercice totalement différent de la prose. Dans un papier de recherche, il ne peut subsister aucune ambiguïté ; tout l'inverse de la fiction, où il est même conseillé de régulièrement laisser le lecteur se faire sa propre interprétation d’une situation délibérément floue ou incomplète. En rédaction scientifique, chaque phrase doit apporter quelque chose, chaque mot doit être correctement choisi – or, ceux qui me connaissent savent que je n’applique pas ce précepte à tous mes récits… 😅
👨🏫 Dans mon domaine de recherche, il y a beaucoup de mathématiques, de formules logiques, de formalisation. L’hyperbole est bannie (je parle bien de l'exagération intentionnelle, pas de la courbe 🤭), de même que la plupart des autres figures de style, mais ce n’est pas frustrant, parce qu’on passe de toute manière du temps à expliquer des choses complexes au lecteur, et on est ravi de pouvoir le faire de façon entrecoupée (par des formules, des exemples, etc.) plutôt que sous la forme d’un texte suivi.
🫖 Autre différence majeure dans mon cas : j’écris ma fiction en français, tandis que la communauté de recherche en informatique réalise la quasi-totalité de ses écrits en anglais. Or, je suis évidemment bien plus à l’aise d’écrire un roman expérimental et truffé de jeux de langue dans la mienne plutôt que dans celle que l’on parle de l’autre côté de la mer. À l’inverse, je souffrirais de voir le français utilisé dans un but purement informatif, où la variété et la beauté des tournures seraient délaissées au profit de leur facilité de compréhension par des confrères de l’autre bout du monde. Je trouve d’ailleurs que l’anglais s'y prête mieux : il remplit cet objectif avec élégance, sans (trop) se dénaturer.
☯️ Mais tout ça, vous le saviez ; c’est évident. Ce qui l’est moins, c’est de constater que, bien que les deux exercices présentent de grandes similarités, leurs différences font en sorte que ces deux activités deviennent, à mes yeux, complémentaires :
1️⃣ Dans aucune des deux disciplines, je ne suis sous pression de rentabilité, car soit j’écris pour mes projets (sans contrainte), soit pour la recherche (où la pertinence l’emporte sur la quantité). Pas de risque de se dégoûter de la rédaction, donc.
2️⃣ En réalité, l’écriture scientifique s’apparente à la limite plus à du code qu’à de la vraie rédaction. Est-ce que quelqu’un qui écrit des mails à longueur de journée, ou qui écrit des programmes de milliers de lignes, a réellement l’impression d’avoir « écrit » ?
En résumé, dans mon cas, ces deux formes d’écriture se complètent, et me procurent un double plaisir créatif. 🥳 🥳
Et vous, comment combinez-vous vos passions et votre gagne-pain ? Se ressemblent-elles ? Avez-vous pu carrément fusionner les deux ? Le rêve ! 😍
À très vite !